Il peut sembler remarquable que le concept de “créolité” soit apparu dans un contexte insulaire. Selon Wikipédia : “Le mouvement de la créolité est né à la Martinique dans les années 1980 sous la plume de Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Jean Bernabé. Le trio publie ainsi en 1989, L'éloge de la Créolité”. Ainsi, au début des années 1980, Glissant propose le concept “d'antillanité” pour décrire l'identité antillaise en ne s'appuyant pas uniquement sur l'expérience des descendants d'esclaves africains, mais en intégrant l'apport des Caraïbes, des colons européens, des Indiens d'Indes, des Chinois et des Syriens. Glissant adhére au mouvement de la créolité. On l’aura compris la créolité est intimement associée à l’intégration de cultures différentes, au métissage dans tous les sens du terme. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à l’émergence de cette idée dans un contexte géopolitique particulier : celui de l’insularité. En effet, les bases culturelles de la créolité existaient ailleurs. Par exemple, aux Etats-unis d’Amériques où les cultures noires, amérindiennes, européennes, asiatiques… se côtoyaient sans pour autant déboucher sur ce concept. A mon avis le confinement territorial produit par l’insularité a joué un rôle essentiel dans l’émergence de l’idée. Le métissage culturel et physique se retrouvant beaucoup plus favorisé dans un tel contexte que sur un territoire beaucoup plus vaste. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que ces pays, géographiquement plus étendus, aient été les lieux d’émergence d’un concept opposé à celui de créolité à savoir celui de “multiculturalisme”. Dans ce dernier cas, les cultures se côtoient mais se mixent peu. Dans certains pays comme le Canada, on considère que les différentes cultures minoritaires constituent une richesse pour l'ensemble des citoyens, et non pas un frein à l'unité nationale. Ainsi, selon la théorie du multiculturalisme, les expressions culturelles minoritaires doivent être encouragées, et les enfants d'immigrés se sentiront davantage chez-eux si l'environnement dans lequel ils évoluent est propice à l'expression des différences culturelles.
Une question qui se pose par rapport à la créolité est celle de l’évolution dynamique de cette idée. En d’autres termes : la créolité conduit-elle à une inéluctable homogénéisation culturelle ? Ne devrait-on pas considérer que la créolité, pour survivre, aurait besoin d’un minimum de multiculturalisme ? Selon ce dernier point, les deux concepts de créolité et de multiculturalisme ne seraient pas opposés mais plutôt complémentaires… Le multiculturalisme, dans certaines conditions de territorialité, notamment en contexte insulaire, serait une sorte de moteur de la créolité. La créolité se nourrit des cultures en contact et, la survie de ces cultures serait une condition nécessaire à celle de la créolité. Cette conception nous rapproche de celle de “l’identité-rhizome” de l’écrivain Martiniquais Edouard Glissant. Pour lui, cette identité est le modèle d’une “poétique de la relation” nouvelle dans le cadre d’une “mondialité” faite de dialogues pluriels opposée aux laminages uniformisateurs de la mondialisation. L’écrivain guadeloupéen Daniel Maximin dans son livre “Les fruits du cyclone” (Éditions du Seuil, Paris, 2006), exprime lui aussi un point de vue voisin lorsqu’il écrit que “Le métissage socioculturel ne saurait se fonder sur l’effacement des couleurs en une seule teinte commune ni sur l’oubli de la peau, mais sur le dépassement de la couleur des peaux”.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
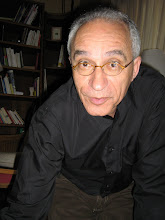
Merci pour cet excellent texte que je n'hésiterai pas un instant à partager avec mes étudiants pour leur faire saisir les richesses et les nuances du multiculturalisme et de la créolité !
RépondreSupprimerJCJ