La question de la laïcité est aujourd’hui dans l’actualité de plusieurs pays. Le débat semble pourtant assez confus entre les partisants de plus ou moins de rigueur en cette matière. Si l’on revient à la définition, la laïcité est fondée sur le principe de séparation juridique des Eglises et de l'Etat (loi de 1905 en France), en particulier en matière d'enseignement.
Cette séparation entraine :
• une garantie apportée par l'Etat dans le domaine de la liberté de conscience et du droit d'exprimer ses convictions (droit de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, d'assister ou pas aux cérémonies religieuses).
• La neutralité de l'État en matière religieuse. Aucune religion n'est privilégiée; il n'y a pas de hiérarchie entre les croyances ou entre croyance et non-croyance.
On constate donc que la laïcité n’interdit pas la ou les religions. On pourrait imaginer deux situations extrèmes : la première étant un “Etat totalement laïque”, soit un Etat qui garantirait une entière liberté sur le plan religieux, qui n’interviendrait jamais en matière de religion. Dans un tel Etat, les risques de conflits religieux seraient importants puisque les différentes religions en présence devraient s’auto-discipliner et faire preuve de tolérance devant l’expression des autres croyances; la seconde serait un “Etat religieux” pour lequel une religion deviendrait religion d’Etat. Ici ce serait à l’Etat de contrôler voire de réprimer toutes les expressions religieuses.
Le “curseur de la laïcité d’un Etat” peut être placé quelque part entre ces deux positions extrèmes. Dès lors, il m’apparaît normal que le débat soit continuel entre ceux qui souhaitent placer ce curseur plus vers le “côté laïque” de l’échelle et ceux qui seraient partisants de le déplacer plus vers le “côté religieux”. La seule solution susceptible de calmer ce débat serait que l'Etat parvienne à établir un consensus en ce domaine dans la population du pays...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
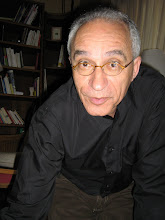
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire