Récemment, au cours d'une interview donnée au journal Le Monde en date du 12-13 décembre 2010, Henri Guaino, conseiller spécial du Président de la République française, indiquait que l'assimilation est le programme de la République. Il souhaitait, entre autre chose, s'opposer aux tenants du communautarisme qui, selon lui, attaque insidieusement les fondements de la République française.
Une nation, quelle qu'elle soit, ne saurait se développer harmonieusement si ses composantes culturelles ne vivent pas dans une certaine harmonie. Les effets de la mondialisation sont, en effet, aujourd'hui présents presque partout dans le monde. Parmi les conséquences qui en découlent, il faut souligner la création de mélanges, de plus en plus hétérogènes, de populations d'origines diverses. Aujourd'hui, il est devenu rare de trouver un pays dont la composition démographique et culturelle est homogène. Partout les cultures se côtoient, se métissent et, malheureusement, parfois, s'affrontent... Dans ces conditions deux possibilités d'évolution sociétale s'offrent aux nations :
Le choix d'un communautarisme de plus en plus marqué, c'est à dire, une évolution vers une situation dans laquelle les cultures se côtoient certes, mais sans trop se mélanger et dans laquelle, chaque groupe culturel sera susceptible de profiter d'un certain degré d'autonomie de gestion au sein de la communauté nationale. Cette façon de procéder peut donner lieu à des situations sociales stables si l'Etat se donne les moyens d'organiser les relations entre les communautés de façon à éviter, le plus possible, les conflits inter culturels. Cette orientation est généralement celle adoptée par les nations de culture anglo-saxonne.
L'autre approche est celle, dite d'assimilation. Elle ne reconnaît pas les communautés culturelles en tant que telles et met en place les mécanismes politico-administratifs capables de les amener à s'intégrer dans un moule commun à l'ensemble de la nation. Cette façon de faire est celle qui est choisie par la France notamment. A première vue, c'est une approche qui devrait poser moins de problèmes, au moins sur le long terme, dans la mesure où les groupes culturels se fondent tous dans un même moule. Elle apparaît donc mieux à même de produire une société harmonieuse... Cependant, à y regarder de plus près, on se rend vite compte que les choses sont plus complexes.
La première remarque concerne la culture nationale. Cette dernière ne peut être que la résultante du mélange des cultures des groupes qui se sont assimilés au sein de la nation. Elle profite de l'apport des différentes cultures qui sont en présence. Il suffit de se rappeler, par exemple, ce que les auteurs originaires de l'Outre-mer ont apporté à la France ne serait-ce que dans le domaine littéraire... Dès lors, toute tentative d'atténuation des cultures d'origines, avec l'objectif de les forcer à se fondre dans le creuset culturel national, risque d'entrainer une perte de vitalité, de créativité, pour la nation, celle-ci ne bénéficiant plus de l'apport original des composantes culturelles exogènes.
Sur un autre plan, l'assimilation jouit généralement d'une triste réputation. Ainsi aux Antilles et en Guyane, notamment, elle a été à la base de la justification de nombreuses dérives : interdiction de l'enseignement et de la pratique de la langue locale, le créole; falsification de données historiques, comme, par exemple, le fait d'enseigner aux écoliers antillo-guyanais que leurs ancêtres étaient des gaulois; déplacements massifs de population vers la métropole où elle venait renforcer la classe ouvrière... Cette dernière disposition étant souvent vécue comme une sorte d'émigration forcée. De façon plus générale, l'assimilation a permis, dans les régions ultra marines, de justifier la négation des cultures locales. En France métropolitaine aussi, l'assimilation n'a pas toujours eu bonne presse. Les phénomènes d'islamisation de la France, sont souvent perçus comme un échec de l'intégration (ou de l'assimilation) des musulmans par la République...
La position correcte semble, comme souvent, se situer entre les deux pôles extrêmes que constituent le communautarisme d'une part, et l'assimilation d'autre part. Il s'agit plutôt de permettre une insertion, aussi harmonieuse que possible, des communautés culturelles émigrantes au sein de la société d'accueil, tout en leur permettant de vivre leur culture à la condition qu'elles respectent les lois fondamentales de la République française. Cette façon de faire, ménageant à la fois les cultures exogènes et endogène, pourrait être désignée par Républicanisation, une désignation qui a le mérite de bien marquer l'adoption des lois républicaines par les émigrants sans, pour autant, exiger l'abandon de toutes leurs valeurs culturelles. Cette approche, bien sûr, pourrait amener la disparition de certaines pratiques culturelles, incompatibles avec la culture de la société d'accueil mais, en aucun cas, elle ne devrait mépriser, a priori, les façons de vivre des nouveaux arrivants.
Mettre en place la Républicanisation, nécessitera un changement profond des mentalités, tant dans le pays d'accueil que de la part des populations émigrantes. Il faudra, en effet, que le pays d'accueil soit suffisamment tolérant pour pouvoir accepter des pratiques inhabituelles de la part des nouveaux arrivants. Ces pratiques devront, évidemment, être conformes aux règles admises dans le pays d'arrivée. Il sera aussi important que les émigrants acceptent de modifier certains de leurs comportements, lorsqu'ils ne sont pas admissibles par la société d'accueil et aussi, qu'ils tolèrent des pratiques, de la part de leurs nouveaux concitoyens, qui pourraient leur sembler inadmissibles, si ces habitudes sont celles pratiquées dans leur nouveau pays.
Tous ces changements de mentalité et d'habitudes prendront du temps et ne pourront être réalisés qu'au travers de l'éducation parentale et scolaire. Il faudra également que les Gouvernements des pays incriminés se concertent afin de faciliter la mise en place de ce nouveau concept. Le Gouvernement du pays d'accueil devra impulser et coordonner la réalisation du changement au travers, notamment, de la réglementation administrative et de la loi. Les Gouvernements des pays de départ seront, au minimum, responsables de l'information des candidats au départ relativement aux nouvelles façons de vivre qui les attendent.
La Républicanisation pourrait ainsi faire que l'avenir de la mondialisation soit moins conflictuel qu'elle ne l'est actuellement et qu'elle l'a été par le passé...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
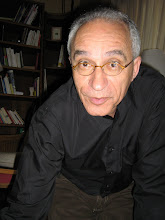
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire