Dans les démocraties occidentales notamment, la notion de volonté populaire est souvent mise à contribution. Il faut se remémorer que ces démocraties sont basées sur cette notion, les élus étant censés représenter le peuple et sont donc, en principe, désignés pour défendre, au niveau de l'Etat, les souhaits de leur population. On pourraît donc dire que, dans une telle démocratie, le pouvoir s'exerce conformément à la volonté populaire...
Cette vision idyllique cependant, ne résiste pas longtemps à un examen critique. Deux faits essentiels au moins viennent contredire cette opinion : il s'agit d'une part, de la tendance croissante à l'abstention qui est observée dans les consultations électorales (voir ma chronique du 15 mars 2010) et, d'autre part du partage quasi égal des voix des électeurs lorsque la consultation fait intervenir un choix entre deux options ou deux candidats. La plupart du temps, les électeurs participants se répartissent autour de 50% pour chacun des deux choix.
Le cas des référendums sur la souveraineté au Québec, est une bonne illustration de ce phénomène. Lors du premier référendum en 1980, le Non l'emporta par 59,56% des voix, tandis que le Oui récoltait 40,44% de celles-ci. La majorité en faveur du refus de la souveraineté était donc de 19,11%. En 1995, le Non obtint 50,58% et le Oui 49,42%. Le rejet de l'option souveraine obtint ainsi 1,16% de majorité. On ne peut que constater ici que, malgré 15 années supplémentaires de campagne pour ou contre l'indépendance, aucune majorité claire ne s'est dégagée au profit de l'une ou l'autre de ces options.
Autre exemple, si l'on considère le cas des huit dernières élections présidentielles en France (de 1965 à 2007), si l'on exclut le cas particulier de l'année 2002 qui a vu s'opposer au second tour Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, l'écart de voix le plus grand qui a été observé s'est produit en 1969 lors de l'opposition de Georges Pompidou (58,21%) et d'Alain Poher (41,79%). Cette année là, le différentiel de voix entre les deux candidats a atteint 16,42%. Dans toutes les autres présidentielles il a été inférieur (à l'exception de 2002) à 10,4%, atteignant même 1,62% en 1974 (Mitterand-Giscard d'Estaing). En 2007, au second tour, l'écart en nombre de voix entre les deux candidats était de 2 192 698 (6,12%) alors que les abstentions s'élevaient à 7 130 729 voix. Autrement dit, les abstentionnistes étaient plus de trois fois plus nombreux que les électeurs qui ont fait la différence entre Nicolas Sakozy et Ségolène Royal....
Cette observation me fait penser à un tirage au hasard. Si on imagine que chaque électeur décidait de son choix au hasard (en lançant une pièce de monnaie par exemple), il est connu que, si la pièce n'est pas biaisée, alors il y a en théorie 50 chances sur 100 d'obtenir le côté "pile" et autant de chances pour "face". Des fluctuations aléatoires viennent en pratique se superposer à ce chiffre théorique de 50%, faisant que, lors d'une expérimentation réelle, on observerait un pourcentage de "pile" voisin de 50% et non pas exactement 50%.
Tout se passe donc, dans la pratique, comme si les choix des êtres humains étaient de plus en plus comparables à des choix au hasard, comme si les personnes n'étaient plus en mesure de faire des choix collectifs mais seulement des choix individuels. Plus exactement, tout se passe comme si il ne se dégage plus de tendance fortement majoritaire au sein des opinions dans les démocraties occidentales. Cette situation peut s'expliquer par l'existence d'opinions individuelles de plus en plus divergentes, celles-ci étant, en tout état de cause, incapables de se coordonner pour faire naître une tendance forte. Cette situation peut provenir du fait que les individus sont aujourd'hui soumis à des flôts d'informations de toutes provenances (voir ma chronique du 18 juillet 2010) et que, d'autre part, les lieux susceptibles de permettre aux humains d'échanger leurs idées en vue de les coordonner, de les harmoniser, se font de plus en plus rares. La rareté contemporaine des pratiques religieuses, la faiblesse des partis politiques, des syndicats, la raréfaction de ces lieux rassembleurs où les humains peuvent entendre, notamment, des leaders d'opinion, la diminution de la lecture de livres et de journaux, la disparition progressive des repas et des réunions familiales, sont sans doute à l'origine de l'étiolement de cette notion de volonté populaire. Tout ceci contribue à isoler les individus, à leur faire perdre la conscience de leur appartenance à des groupes de pensées et, finalement à développer l'individualisme et la peur du changement. Il est bien connu que l'union fait la force, mais il est primordial d'avoir le sentiment d'être uni aux autres ne serait-ce que par la communauté des idées...
Il ne faut pas croire que l'Internet peut remplacer ces lieux de frottement des idées, de convergences des opinions, car ce média est surtout propice à des échanges individuels et se prête peu à l'émergence de pensées collectives même si, parfois, il peut favoriser des actions collectives (apéros géants, manifestations publiques,...). Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur les nombreux forums qui fleurissent sur l'Internet. Il est très rare de voir émerger un consensus de ces échanges, chacun y venant avec l'idée principale d'y affirmer son point de vue...
Il faudra bien ,un jour, revenir à des pratiques favorisant le débat d'idées en vue de l'émergence de consensus intellectuels, faute de quoi nos sociétés risquent de s'orienter de plus en plus vers un individualisme forcené et donc vers l'anarchie....
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
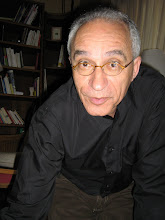
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire