J'ai souvent été amusé par le concept d'émigration choisie. En effet, le qualificatif ici est souvent compris et pensé comme référant à un choix de l'émigrant par le pays d'accueil. Or, si on y réfléchit bien, on sait tous qu'il n'y aurait pas d'émigration du tout si la décision d'émigrer n'était pas avant tout celle de la personne concernée. Donc, s'il y a choix dans cette affaire, c'est avant tout le choix de l'individu et pas celui du pays.... C'est le premier paradoxe. D'ailleurs si l'on y regarde de plus près, le choix de quitter son pays pour un individu est souvent une décision subie plus que désirée. On serait donc plutôt dans une émigration subie.
Maintenant si l'on regarde le point de vue du pays d'accueil, il choisit ses futurs immigrants en fonction de certains critères bien définis. Cette façon de faire implique que ce pays a des besoins particuliers en ressources humaines qu'il tâche de combler par cette émigration. Or, ce que l'on constate souvent (c'est le cas notamment au Québec) c'est, qu'une fois parvenus dans leur pays d'accueil, ces émigrants sont quasiment abandonnés à eux-mêmes et ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi, une action qui, comme on le sait aujourd'hui, est la base de toute intégration réussie. C'est là le second paradoxe.
Lorsque le pays d'accueil fait ses choix, il considère un certain nombre de critères que doivent remplir les personnes candidates à l'émigration. Parmi ces critères figurent souvent le diplôme et la langue (le français, par exemple, pour le Québec). Une fois établis dans leur nouveau pays, les immigrants constatent bien souvent que leurs diplômes, qui ont pourtant servis à les qualifier pour l'acceptation dans leur nouveau pays, ne sont plus reconnus par ce même pays. Comme si, les mêmes diplômes qui étaient validés par le pays d'accueil, ne le sont plus aussitôt que les personnes ont émigrées.... C'est le troisième paradoxe.
Il en va presque de même de la langue française qui, alors qu'elle était un point favorable dans le dossier d'émigration, une fois parvenu dans certain pays d'accueil (c'est le cas au Québec) peut devenir un frein à l'emploi, l'anglais devenant alors la langue qualifiante... Autre paradoxe.
On pourrait ainsi décliner bien d'autres paradoxes dans cette conception de l'émigration choisie. Je pense qu'en cette matière il vaudrait mieux qualifier les choses autrement et rejeter cette appelation qui repose sur trop de paradoxes. Emigration subie serait trop connotée négativement et je propose plutôt émigration acceptée (acceptée par le migrant) ce qui aurait l'avantage de porter l'accent sur l'adaptation nécessaire de la personne qui migre aux réalités culturelles de son nouveau pays....
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
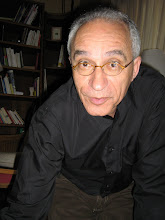
En fait, pour le pays d'accueil, le mot émigration est... mal choisi car il s'agit d'une immigration sélective. Mais, rectitude politique oblige, pourquoi faire simple ? Or, il s'agit d'immigration tout simplement, avec ses lois, procédures et contraintes.
RépondreSupprimer