Le « manifeste pour un Québec éduqué » publié récemment par des enseignants du Québec arrive à point pour remettre l'accent sur une dérive observée très souvent dans les sociétés modernes : celle qui consiste à confier les commandes de services d'intérêt général comme la formation des jeunes ou la santé des citoyens à des gestionnaires. Cette dérive est pourtant bien connue elle se nomme « bureaucratie »,...
Les professeurs, étudiants et retraités, signataires de ce manifeste s'élèvent notamment contre une loi du ministère de l'Éducation du Gouvernement du Québec qui oblige les cégeps à fournir un plan stratégique sur une période de plusieurs années, plan qui doit tenir compte, en outre, du plan stratégique que le Ministère élabore lui-même. Or, ce plan doit comporter des objectifs et les moyens que les cégeps mettront en oeuvre pour les réaliser, y compris des cibles chiffrées. Le respect de ces objectifs, imposés d'en haut, amène les enseignants et les directions d'établissements à « forcer la réalité » afin de satisfaire les autorités hiérarchiques. C'est ainsi que des enseignants sont conduits à abaisser leurs exigences pour favoriser l'octroi de diplômes et satisfaire par ce moyen aux objectifs imposés. Ils sont aussi amenés à consacrer plus de temps à la pédagogie (la dernière trouvaille étant la « pédagogie universelle ») qu'à la découverte et à l'amour de leur discipline. Ce phénomène est bien connu des professeurs des universités qui sont, eux aussi, contraints à satisfaire des directives imposées d'en haut au détriment de la formation de leurs étudiants.
Dans un autre domaine, celui de la Santé on peut observer le même genre de dérive. Les médecins, soient les vrais acteurs de la santé, sont souvent aux prises avec des normes comptables et des règlements imposés par la bureaucratie.
Sur le fond, ces méthodes visent à renforcer l'efficience des systèmes de formation ou de santé, ce qui est, en soi, un objectif louable. Dans les faits, on peut douter des résultats obtenus lorsque l'on voit le gâchis auquel peut conduire ce mode de gouvernance. Faut-il rappeler les taux très importants de « décrochage scolaire» qui frappent les jeunes dans nos sociétés ? Est-il besoin d'insister sur les files d'attente qui perdurent dans les urgences des hôpitaux? Les gouvernements, à chaque élection, promettent pourtant de régler rapidement ces difficultés... Il est donc clair que la gestion bureaucratique n'est pas la bonne approche des problèmes.
Les choses sont encore plus catastrophiques lorsque il s'agit de la politique d'un Etat. On sait maintenant que la crise mondiale grave qui a débuté par la récession de l'économie des Etats-Unis d'Amérique en décembre 2007, a, pour partie, son origine dans les mauvaises décisions du Président Bush. Selon l'économiste Joseph E. Stiglitz (voir « Le triomphe de la cupidité », J.E. Stiglitz, Editions Babel, France, 2010, pages 84-85) : « Malgré la montée des pertes d'emplois, malgré une baisse de 24% du Dow Jones depuis janvier 2008, le président Bush et ses conseillers ne cessaient de répéter que la situation n'était pas aussi mauvaise qu'elle en avait l'air. Dans un discours prononcé le 10 octobre 2008, Bush précisa : « Nous savons quels sont les problèmes, nous avons les outils qu'il faut pour les résoudre, et nous travaillons vite » ». Il est certain que les origines de cette crise mondiale sont multiples et que le président Bush ne peut être considéré comme le seul responsable. Néanmoins, le feu vert qu'il a donné aux différents acteurs par son attitude insouciante a contribué grandement à aggraver la situation. La non prise en compte des signaux annonciateurs de la crise, comme, par exemple, les difficultés que subissaient les citoyens, notamment en matière de crédits immobiliers, a beaucoup favorisé la récession.
Que faire alors ? Il me semble que les problèmes doivent être abordés dans un premier temps « par le bas », c'est à dire au niveau des acteurs en cause. En matière de formation, ceux-ci sont les enseignants et les apprenants. Ce serait donc d'abord à eux de fixer les objectifs en matière de pédagogie et de diplôme. Les gestionnaires devraient ensuite prendre le relais afin de mettre en place la réglementation et les ressources propres à permettre l'atteinte de ces objectifs. Pour la Santé, ce sont d'abord les médecins et les infirmières et infirmiers qui devraient déterminer les objectifs. Les services administratifs et de gestions prendraient ensuite le relais pour réaliser ces objectifs. D'une façon générale, il me semble que les gestionnaires doivent être au service des acteurs de la profession et pas l'inverse comme on l'observe malheureusement trop souvent dans les sociétés dites « modernes ». Viendrait-il à l'esprit d'un fabricant d'avion de confier la réalisation des plans d'un appareil au service de gestion de l'entreprise plutôt qu'aux ingénieurs et techniciens ?
L'influence de l'administration doit être constamment modérée par le poids attribué aux acteurs du terrain en mettant en place, dans la gestion des projets, une composante auto gestionnaire non négligeable.
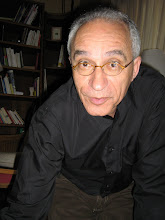
Moi, je suis contre les gens qui sont contre la vie de bureau !
RépondreSupprimerCeci dit il n'y a pas plus contre le bureau que moi, j'y suis collé toute la journée et ne m'en décolle que pour me coller à mon autre douce moitié (qui ressemble plutôt à un bahut normand).
Donc en fait je suis pour être contre le bureau et contre ce qui sont pour pour ne pas être contre ceux qui sont pour le bureau...
Vive la vie de bureau !
http://www.zarbo.info
Et bonjour Jean-Pierre !