On ne peut qu'être surpris, sinon inquiet, de lire ( La Recherche n° 453, p. 81-83 ) l'avis du professeur Jean-Yves Chemin affirmant la nécessité impérieuse pour les universités françaises, si elles veulent exister à l'international, de proposer des cursus tout en anglais. Fort heureusement, ce point de vue est contrebalancé par celui du professeur Claude Truchot qui rappelle notamment que l'enseignement en anglais abaisse le niveau des formations.
Que la pratique de l’anglais soit actuellement mondialement répandue, en particulier dans les activités financières et commerciales, est un fait. Si permettre la communication internationale est évidemment indispensable dans les sciences, faut-il obligatoirement le faire avec une langue unique, au prix d'approximations (l'anglais ne peut suffire dans toutes les sciences à représenter l'ensemble des concepts) et d'un effet logique d'économie de moyens : la disparition à terme dans les systèmes éducatifs de nombreuses autres langues et des cultures qui leur sont intimement liées ?
L’anglais comme langue internationale unique n’est pourtant pas la seule solution. Pour notre part, nous avons montré qu’une autre approche était concevable : si, par exemple, chaque élève apprenait deux ou trois langues, librement choisies par lui parmi une dizaine enseignées, la probabilité qu’une fois adultes deux interlocuteurs pris au hasard aient une langue commune ( pas obligatoirement l’anglais ) serait alors de l’ordre de 80 % ( «Un modèle probabiliste pour la diversité linguistique : le cas de la romanité dialogale » dans « L'intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes », Editions de l'Union Latine / Agence universitaire de la Francophonie, Paris, 2011 ). L'expertise et les outils d'apprentissage précoce, sur objectifs spécifiques et multilingues existent et sont largement expérimentés, notamment dans les universités françaises souvent en pointe dans ce domaine. Une telle politique linguistique éducative pourrait favoriser une réelle capacité de communication internationale ainsi que les mobilités les plus diversifiées tout en valorisant une nécessaire diversité des répertoires linguistiques scientifiques des étudiants et des enseignants. La croyance au caractère incontournable de l’anglais est donc un a priori non fondé.
ps : ce texte a été élaboré conjointement par le responsable du blogue et deux autres collègues universitaires : André Rouillon (informaticien) et Patrick Chardenet (linguiste)
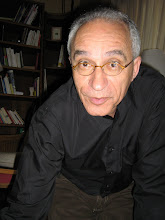
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire