samedi 2 juin 2012
Et après ?
Au sortir de l'échec des négociations entre le gouvernement du Québec et les étudiants il apparait clairement que le gouvernement a fait une grave erreur d'appréciation dans son analyse de cette crise. En effet, peu de temps après l'annonce par le gouvernement de sa décision de hausser les droits de scolarité, en mars 2011, à raison de 325$ par année pendant cinq ans, les étudiants ont fait connaitre leur opposition. En effet, dès le mois d'août les étudiants lancent officiellement leur campagne de protestation contre cette hausse. Ils font savoir rapidement que, pour eux, l'amélioration du financement des universités ne devrait pas être obtenue en prélevant plus d'argent dans la poche des étudiants mais plutôt en améliorant la gestion des universités de façon à réduire les dépenses pas toujours justifiées. Cette proposition est formalisée par la FEUQ (Fédération étudiante universitaire du Québec) et la FECQ (Fédération étudiante collégiale du Québec) le 1er mai 2012 et elle contient déjà un point sur le gel des droits de scolarité. Le gouvernement a préféré ignorer cette proposition et a maintenu sa décision, comme il a ignoré les centaines de milliers de manifestants qui protestaient dans les rues de Montréal notamment. Pire encore, après le déclenchement de la grève des étudiants le 13 février 2012, le gouvernement a mis onze semaines avant de réagir et de recevoir les représentants des étudiants à la table de négociations. Ce délai de réaction était une preuve supplémentaire de l'inflexibilité gouvernementale, de son désir de considérer sa proposition comme définitive et non négociable. Par la suite, au cours des deux périodes de négociations, le gouvernement québécois n'a jamais accepté d'envisager un moratoire sur la question du gel des droits de scolarité ou une procédure qui produirait le même effet comme le souhaitait les leaders étudiants.
D'un autre coté, il était tout aussi clair que, pour les étudiants, il n'était pas question d'accepter le principe de l'augmentation des droits de scolarité mais qu'ils souhaitaient plutôt discuter de la gestion des universités afin de la rationaliser, de la moraliser et de faire des économies substantielles. Pour eux, les droits de scolarité devaient être gelés et ce au moins jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. Leur souhait à plus long terme était d'améliorer l'accessibilité aux études supérieures en diminuant les droits de scolarité avec le but de tendre vers la gratuité. Il est bon de rappeler ici une intervention du Recteur actuel de l'UQAM, Claude Corbo, qui déclarait lors d’une allocution tenue devant la Chambre de commerce de Montréal en février 1993 : « les étudiants doivent consacrer plus de temps à leurs études et moins de temps à leur travail s’ils veulent réussir. ». Il est évident, en effet, que si les étudiants doivent consacrer une partie de leur temps à gagner de l'argent pour payer leurs études, ce sont autant moins d'heures qu'ils pourront accorder à leur travail universitaire. Il faut également rappeler que le modèle des universités des Etats-Unis-d'Amérique qui est souvent cité en exemple au Québec, est un modèle qui a conduit à ce que, à l’heure actuelle, la dette moyenne d’un étudiant américain s’élève à plus de 25 000 $. Selon le quotidien québécois « Le Devoir » du 2 juin 2012 : « Aux États-Unis, modèle souvent évoqué par ceux qui veulent augmenter les droits de scolarité, l’endettement des étudiants est en train de devenir une bombe à retardement sociale et financière. »
Dans ce contexte, il apparait que les deux phases de négociations qui ont eu lieu ne pouvaient aboutir. Le vote de la loi spéciale, le 18 mai 2012, par le Parlement de Québec est venu aggraver la situation en élargissant l'assiette des manifestants au delà du monde étudiant jusqu'à l'ensemble de la société québécoise attachée à l'expression démocratique de ses droits.
Que pouvons nous espérer maintenant ? Il semble que la seule issue possible à ce conflit soit le déclenchement d'élections provinciales, à plus ou moins long terme, afin de pouvoir débloquer la situation et choisir un modèle de financement des études post secondaires qui soit consensuel. Dans cette perspective, il apparaît qu'un engagement politique déterminé des jeunes, étudiants et collégiens notamment, est une nécessité. L'énergie, la ténacité, la détermination et l'intelligence qu'ils ont mis dans la conduite du mouvement de protestation étudiant doivent maintenant être mis à profit du combat politique pour un Québec moderne.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
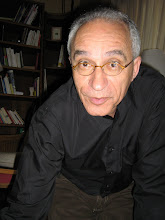
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire