Ce débat est à mon avis dépassé. En effet, quelle valeur accorder à une telle discussion alors même que les nations sont pratiquement toutes engagées dans des processus d’intégration au sein d’ensembles supra-nationaux? La France notamment, est maintenant bien insérée dans la construction de l’Union Européenne et l’on connait les conséquences, souvent décriées, des abandons de souveraineté qui s’en suivent. Cette insertion progressive des nations au sein d’ensemble plus vastes est une donnée historique qui concerne quasiment la totalité des pays du monde contemporain. Citons, sans prétendre être exhaustif, l’Union Africaine, l’Accord de Libre Échange Nord Américain, l’Union des Républiques Arabes, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, etc… Parallèlement à ces mouvements intégrationnistes, la mondialisation produit un renforcement des flux migratoires essentiellement des pays les plus pauvres vers les plus riches. Ces mouvements viennent à leur tour affaiblir les identités nationales en renforçant les pôles culturels au sein des pays. Le phénomène de « différentiation » des communautés culturelles émigrantes au sein des pays d’accueil leur pose aujourd’hui de plus en plus de problèmes, d’autant plus que par ailleurs, ils traversent souvent une crise économique plus ou moins sévère. Le « mal des banlieues » en France, le grand déballage auquel ont donné lieu les audiences publiques de la Commission mise en place par le Gouvernement du Québec afin d’établir un rapport sur la question des « accommodements raisonnables » (sorte de compromis réglementaire destiné à adapter le droit québécois à la demande spécifique d’un membre d’une communauté culturelle), le renforcement des protections aux frontières du Sud des USA ou aux frontières de l’Union européenne, l’affaire des caricatures de Mahomet au Danemark, les refus français et néerlandais du Traité constitutionnel européen… Tous ces exemples témoignent des conséquences de cette différenciation.
Tout cela me conduit à penser que les problèmes contemporains sont de nature plus culturelle qu’identitaire. Bien entendu, ces deux aspects, identitaire et culturel, sont très liés mais en traitant la question sous l’angle de la culture on risque moins la crispation et le réflexe de « défense identitaire ». Il me semble d’ailleurs significatif que l’UNESCO ait adopté, le 21 octobre 2005, par 146 voix sur 154 présents, la « Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ». Ce document stipule que les États et Gouvernements des pays signataires se doivent de mettre en place toutes les dispositions susceptibles de permettre à leurs propres cultures de continuer à se développer. Ils doivent simultanément se garder de renforcer les « murs identitaires » et ne pas oublier, comme l’écrit Joëlle Farchy dans le Journal « Le Monde » en date du 29 mai 2007 que « chaque individu est porteur d’identités multiples qui ne peuvent être réductibles à l’identité nationale… De plus, les identités collectives sont mouvantes ; en France, pas plus qu’ailleurs, il n’y a de valeurs établies une fois pour toute dans lesquelles chaque nouvel arrivant est sommé de se fondre. Grâce à un processus d’échanges interactifs, les identités évoluent. Le vrai défi est de parvenir à un juste équilibre, afin de respecter les identités existantes, et de leur permettre de s’enrichir par l’ouverture aux autres cultures du monde ». Le vrai défi de notre temps réside dans la découverte d’approches, aussi consensuelles que possible, susceptibles de permettre de donner une existence concrète à la diversité culturelle qui concerne la totalité de notre monde contemporain.
L’examen de la question à cet éclairage doit conduire à détecter les valeurs qui solidifient et valorisent non pas directement notre identité nationale mais plutôt notre identité culturelle. Celle-ci se fonde notamment sur la langue française et elle devrait être mieux considérée par les responsables et décideurs. Son abandon quasi systématique au bénéfice de l’anglo-américain, tel qu’il est trop souvent prôné au nom d’une soi-disant efficacité, devrait être remplacé par sa valorisation dans l’enseignement, la recherche et dans le monde du travail principalement. N’oublions pas que la langue est aussi un facteur d’intégration culturelle et que la France, ainsi que tout l’espace francophone mondial, pourrait s’appuyer sur elle pour mettre en place un environnement culturel, social et économique plus harmonieux. Promouvoir le français ne doit pas être perçu comme une déclaration de guerre aux autres langues, mais bien comme une reconnaissance de l’égalité entre les langues du monde, chaque pays mettant en place non seulement les moyens de faire rayonner sa propre langue mais aussi de développer l’apprentissage d’autres langues du monde d’intérêt pour lui. Nous avons nous-même démontré mathématiquement[1], qu’un processus d’apprentissage ouvert aux langues du monde et ne privilégiant pas la seule langue anglaise, pouvait permettre aux êtres humains de communiquer dans une langue partagée avec une probabilité de l’ordre de 80%. D’une façon plus générale, toutes les industries de la culture et de la communication devraient être mises à profit pour favoriser la diffusion de la langue et de la culture. La télévision et le cinéma sont sur ce plan deux outils clés à ne pas négliger. Compte-tenu des coûts afférents, il serait opportun de mutualiser ceux-ci en rassemblant les ressources des pays francophones autour de projets culturels et linguistiques communs. La Francophonie politique devrait s’emparer de cette question avec détermination. La diversité culturelle est, en effet, une réalité tangible de l’ensemble francophone mondial (200 millions de locuteurs environ; le français est la langue officielle de 32 États; le français est la 9e langue la plus utilisée dans le monde; le français est la 2è langue la plus apprise dans le monde (85 millions d'apprenants); le français est la seule langue, avec l'anglais, parlée sur les 5 continents; la Francophonie politique est une organisation politique multilatérale qui rassemble aujourd’hui 70 États et Gouvernements dont 56 comme membres à part entière et 14 en tant qu'États observateurs).
Bien entendu, la diversité culturelle devrait être mieux valorisée sur le territoire français lui-même. Cette question a déjà fait l’objet de larges débats au plan national et tout ce qui va dans le sens d’un renforcement de la prise en compte de cette diversité nationale doit être encouragé. Je voudrais cependant aborder ici un aspect particulier de cette question relative à la place des populations françaises des outre-mers au sein de la Francophonie. En considérant les Départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion), les Collectivités d’outre-mer (Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna), la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, ce sont environ 2 300 000 personnes qui sont concernées. Ces territoires se singularisent de la métropole tant par leur situation géographique excentrée, que par leur peuplement. Ce sont des laboratoires exemplaires de la diversité culturelle et linguistique. Comme l’écrit Dominique Wolton (« L’autre mondialisation », Ed. Flammarion, 2003) en page 123 : « Si ces outre-mers n’existaient pas, on rêverait qu’ils puissent exister. Ils existent, et la France au lieu d’en être fière, oscille entre la culpabilité de l’ancienne puissance coloniale et la sympathie pour ces racines mondiales ». Actuellement, ces communautés francophones ne jouissent d’aucune ou d’une très faible visibilité en France, mais aussi en Francophonie. Or, leur statut particulier devrait, selon moi, être valorisé au sein de l’espace francophone, espace qui revendique haut et fort la mise en application de la diversité culturelle et linguistique. Nous pensons que la présence de la France au sein des institutions de la Francophonie pourrait bénéficier de l’apport de représentants de ces collectivités d’outre-mer. La Francophonie a pourtant déjà procédé à la reconnaissance de telles spécificités en permettant au Canada d’être accompagné du Québec et du Nouveau-Brunswick.
[1] JP Asselin de Beauville, Un modèle probabiliste simple pour le multilinguisme, 78è Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal (Québec-Canada), 10-14 mai 2010.
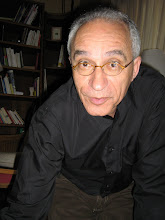
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire