La difficulté de communiquer est bien connue et ce, depuis longtemps. Elle est reliée à de nombreuses raisons, parmi lesquelles la description précise et objective de la réalité n'est pas la moindre. Communiquer fait, en effet, appel à plusieurs activités cérébrales : penser, observer, décrire, interpréter...
Les physiciens ont mis l'accent sur la question de l'observation et de la description, particulièrement dans le cadre de la physique quantique. Le "principe d'incertitude" fut énoncé en 1927 par Heisenberg. Ce principe ne porte pas sur l'ignorance subjective par l'expérimentateur de grandeurs, mais bien sur l'impossibilité de les déterminer, et même d'affirmer qu'une détermination plus précise de ces grandeurs existe. De manière simplifiée, ce principe d'indétermination énonce donc que — de façon assez contre-intuitive du point de vue de la mécanique classique — pour une particule massive donnée, on ne peut pas connaître simultanément sa position et sa vitesse. Une autre façon d'exprimer les choses a souvent été mise en avant par les théoriciens de la physique : l'observation de la réalité modifie cette réalité. En conséquence, il devient impossible de connaître précisément cette réalité. C'est, en fait, la mesure qui perturbe le système et le fait bifurquer d'un état quantique vers un autre état. Cet état ne préexiste pas à la mesure : c'est la mesure qui semble le faire advenir...
Ici, il est question du niveau atomique de la réalité et on pourrait se demander en quoi cela est en relation avec l'observation du monde au plan macroscopique ? Une réponse simple est que le monde étant constitué d'atomes, il est fort probable que les aspects quantiques de la physique doivent aussi se faire sentir au niveau macroscopique. En fait, cette relation entre les deux niveaux d'observation a été mise en évidence, dès 1935, par le physicien Erwin Shrödinger. L'expérience du chat de Schrödinger a justement été imaginée pour faire surgir l'indéterminisme microscopique dans le monde macroscopique de notre vie quotidienne. L'idée de Schrödinger consiste à placer un chat dans une boite fermée. Cette boite est pourvue d'un système destiné à tuer le chat (il s'agit évidemment d'une expérience de pensée.). Ce système est constitué d'un flacon de poison, d'une petite quantité de matière radioactive et d'un compteur Geiger. Lorsque la première désintégration d'un noyau radioactif se produit, le compteur Geiger réagit en déclenchant un mécanisme qui casse le flacon et libère le poison mortel. Ainsi, la désintégration d'un noyau radioactif, un processus microscopique, se traduit par la mort du chat, un événement macroscopique. La désintégration d'un noyau radioactif est un processus purement quantique qui se décrit donc en termes de probabilités. Il est impossible de prévoir quel noyau se transformera en premier ou bien quand la première désintégration se produira. La seule chose que nous puissions calculer est la probabilité qu'un certain nombre de noyaux se soient désintégrés après un temps donné. Nous pouvons en particulier choisir une substance radioactive adéquate de telle façon qu'après cinq minutes, il y ait 50 pour cent de chances qu'un noyau se soit désintégré et 50 pour cent de chances que rien ne se soit produit.
Fermons donc la boite et patientons pendant cinq minutes. Puisque la désintégration radioactive s'exprime en termes de probabilités, le sort du chat ne peut être décrit qu'en termes similaires. Après cinq minutes, il y a donc 50 pour cent de chances que le chat soit mort et 50 pour cent de chances qu'il soit vivant.
Dans l'interprétation traditionnelle de la mécanique quantique, le chat n'est alors ni mort, ni vivant. Il se trouve dans une superposition de ces deux états. Ce n'est que lorsque nous ouvrons finalement la boite que l'un des deux états possibles devient la réalité. Le chat est alors soit vivant, soit mort.
Les sociologues connaissent, eux aussi, des difficultés au plan de l'observation et de la description de la réalité. Ils ne partagent pas nécessairement la même représentation mentale de la réalité sociale. Là où certains voient une multitude d’acteurs individuels poursuivant chacun leur propre logique, d’autres considèrent que les groupes sociaux, dont les individus font partie, ont une action prépondérante. Une représentation permet de décoder une réalité sociale complexe en lui appliquant un “schéma de perception” réduit à quelques éléments et relations essentiels. Ainsi, les concepts de "catégorie sociale", "classe sociale", "groupe social", traduisent chacun une forme de représentation sociale, une “vision” du monde. Pour éviter une représentation subjective, celle-ci devrait, selon certains, être “savante” : classements, modèles et théories élaborés par l’étude scientifique (et donc rationnelle) des faits sociaux.
En intelligence artificielle, on sait qu'une représentation ou une description parfaite de la réalité est impossible. La représentation, dans la mémoire d'un ordinateur, d'une "forme" au sens large (geste, parole, écriture, etc) nécéssiterait une infinité de variables alors, qu'en pratique, on doit se limiter à un nombre fini de variables descriptives, ne serait ce que pour des raisons de place en mémoire de la machine. Pensons, par exemple, au nombre de variables nécessaires pour représenter en mémoire une personne humaine. On pourrait la décrire par sa taille, son poids, sa pointure de chaussure, la couleur de ses yeux, celle de sa peau, son tour de taille etc. Où doit-on s'arréter ?
Pour dire les choses simplement, nous diront que la traduction d'une réalité par un observateur, quel qu'il soit, en vue de la faire partager par d'autres, est une opération qui présente bien des difficultés. En effet, outre les difficultés soulevées au niveau atomique, les faits sont appréhendés au travers de multiples prismes déformants parmi lesquels on peut citer : la culture (de l'émetteur et du récepteur), les objectifs visés qui peuvent différer selon, par exemple, les choix politiques des individus, l'état mental des personnes (un observateur ou un récepteur déprimé ne sera probablement pas équivalent à un individu en pleine forme)...
Dès lors, il n'est pas surprenant de constater, à travers les médias par exemple, combien un même évènement peut être traiter de façons diverses. Les récentes grèves, à l'occasion de la modification de la loi sur les retraites en France, nous ont permis de percevoir concrètement ce phénomène. Pour les syndicats et pour la presse de gauche qui soutenaient ce mouvement, il avait son origine dans la souffrance subie par les travailleurs au cours de leur vie professionnelle. Il était parfaitement juste et le Gouvernement français se devait de tenir compte de l'expression du mécontement relatif à la nouvelle loi. Le point de vue économique était mis en avant par les partis et la presse de droite qui insistaient, eux, sur la nécessité d'ajuster les paramètres économiques au vieillissement de la population française afin d'éviter une faillite future du pays qui croulerait sous les dettes. Depuis l'étranger, les observateurs insistaient plutôt sur la paralysie de la France qui résultait de ces mouvements de grève. Les autorités des Etats-unis d'Amérique et du Royaume uni, notamment, ont même été jusqu'à recommander à leurs ressortissants de ne pas se déplacer en France...
On voit là combien une même réalité est difficile à traduire par des observateurs distincts. Mais, pire encore, la réception des informations souffre, elle aussi, des mêmes maux. Certains pourront effectivement croire que la France est au bord du gouffre. D'autres, au contraire, verront dans ces évènements l'expression du sens critique des français et leur propension à faire évoluer les décisions politiques par les manifestations de masse. D'autres encore insisteront sur le caractère culturel, ludique et festif de ces manifestations qui sont un moyen pour le peuple français d'entretenir le lien social dont il est friand...
Que doit-on déduire de ces difficultés à appréhender l'objectivité d'une réalité ? A mon avis, il serait essentiel que les décideurs (politiques notamment) prennent mieux en compte ce phénomène, de la relativité de certaines visions, de la diversité des points de vue, et qu'ils en viennent à traduire cette situation par une attitude plus tolérante, plus conciliatrice. Qu'ils manifestent plus d'empathie envers les personnes dont ils sont les représentants, élus ou non. Les acteurs devraient être convaincus que leurs points de vue diversifiés ont été, au moins partiellement, entendus. Cela nécessite du temps, bien sûr, mais aussi de la pédagogie. Les partis politiques, les responsables d'entreprises notamment, devraient tenter plus souvent de débattre sereinement des différents points de vue en présence et éviter les "passages en force" qui ne peuvent consister qu'en des victoires à court terme, tandis que les problèmes de fond, les insatisfactions finiront toujours par ressurgir un jour ou l'autre....
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
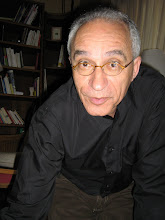
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire