Dans la plupart des « démocraties occidentales », les responsables politiques paraissent s'être placés eux-mêmes dans une impasse quant à leur crédibilité auprès de l'électorat. Celle-ci, et c'est bien connu aujourd'hui, se trouve au plus bas dans la plupart des pays occidentaux. Les causes de cette perte de confiance des électeurs sont multiples : la corruption et les « affaires » bien entendu, mais aussi, une certaine impuissance à améliorer la situation, à régler les problèmes des citoyens. Enfin, la déception de l'électorat face à des promesses toujours présentes mais rarement tenues... Généralement, la cause première de cette situation se trouve dans les positions incohérentes, presque masochistes, des décideurs politiques qui, après s'être privés des moyens d'agir ou même après avoir détruit ce qui fonctionnait, tentent de rétablir les choses...Voici trois exemples de cet état de fait :
Le chômage des jeunes en France : les gouvernements se succèdent, passant de la gauche à la droite ou réciproquement, les bonne intentions des responsables politiques s'affichent régulièrement et pourtant, malgré un effort financier le plus important des pays de l'OCDE, le taux de chômage des jeunes en France reste le double de la moyenne nationale, 20,7% pour l'année 2000, contre 11,8% pour l'ensemble des pays de l'OCDE. En février 2010, soit 10 ans plus tard, ce taux en France est encore de 25%... Ce phénomène est loin d'être limité à la France, il touche beaucoup de pays. "Le chômage des jeunes dans le monde a atteint le plus haut niveau jamais enregistré et devrait encore augmenter en 2010", a précisé le BIT dans un rapport sur l'emploi des jeunes. Le taux de chômeurs est passé de 11,9 % en 2007 à 13 % l'année dernière. Il devrait progresser légèrement à 13,1 % en 2010 avant de retomber à 12,7 % l'année suivante, selon les projections de l'organisation.
Les raisons de cet échec sont multiples même si on sait, aujourd'hui, que le chômage des jeunes amplifie les fluctuations de la conjoncture économique. Toutes les études le montrent, le diplôme est encore la meilleure protection contre le chômage, mais les phases de raréfaction de l'embauche conduisent à une déqualification des emplois, les plus diplômés acceptant des postes occupés, dans les phases de haute conjoncture, par des diplômés de niveaux intermédiaires ; en fin de chaîne ce sont les moins qualifiés qui pâtissent le plus de la basse conjoncture.
Si l'on considère la question de la formation des jeunes et de leurs qualifications, qui interviennent aussi dans leur avenir professionnel, on retrouve un schéma voisin de celui décrit ci-dessus. En effet, les responsables politiques, pourtant conscients de l'importance de la formation en matière d'emploi, n'ont pas réussi au cours des années, à faire croître le taux de diplômés d'une classe d'âge donnée. En 1970, la France par exemple, avait un pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur inférieur à la moyenne de l'OCDE. Aujourd'hui, c'est toujours le cas pour les diplômes de l'enseignement supérieur long : 24% contre 27% pour l'OCDE et 33% pour l'Europe. Une particularité de la France est le faible taux de scolarisation des 20-29 ans et surtout le fait que ce taux n'ait pas augmenté depuis 1995...
Or, si l'embauche, toutes catégories de la population et tous pays confondus, diminue c'est en grande partie à cause des délocalisation des emplois que permet la mondialisation libérale, par ailleurs tant vantée et soutenue par les responsables politiques. Les pays capitalistes développés et leur instrument, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), poussent au démantèlement général des barrières douanières. Celui-ci est déjà très avancé pour l’industrie. L’agriculture est encore un sujet de conflits (pour des raisons de compromis sociaux, l’Europe et les USA ont chacun des systèmes de protection et de subvention de leur agriculture). Les services constituent un chantier hétérogène et conflictuel (nouveau champ de profit, tentatives de remise en cause des services publics). La mondialisation de la finance est la modalité la plus avancée de la mondialisation, même si ce n’est pas la première fois dans l’histoire qu’on est en présence d’un rôle important des marchés financiers (fin XIX°). La plupart des pays du monde ont aujourd'hui libéré les entrées et sorties de capitaux, dont les mouvements internationaux augmentent et s’accélèrent. Tous ces développements sont organisés, soutenus et valorisés par les politiciens au pouvoir dans la plupart des démocraties occidentales.
Dès lors, comment croire le Président de la République française, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a affirmé, mardi 16 novembre 2010, à la télévision française, que "le chômage reculera l'année prochaine" et que l'engagement du gouvernement sera "total sur ce front-là", notamment en faveur des licenciés économiques et des jeunes. Que l'on soit libéral, néolibéral ou ultra-libéral ne change rien au fait que les gouvernements résistent peu à l'extension tous azimuts de la mondialisation et participent même à sa mise en place... En conséquence de quoi, il est difficile de les croire lorsqu'ils affirment à l'intérieur de leurs frontières, vouloir faire diminuer le chômage des jeunes tout en négociant à l'extérieur des frontières nationales, l'extension de la mondialisation libérale... Ce faisant, ils se privent eux-mêmes des moyens nécessaires à la résolution des difficultés vécues par leurs citoyens.
Mais les exemples de l'incohérence et de l'impuissance des responsables politiques ne sont pas restreints à la seule France. Le cas suivant est pris au Canada-Québec en donne une autre illustration.
Le système de santé au Québec : il est un fait avéré que le système de santé au Québec présente, depuis fort longtemps, des difficultés : les dépenses colossales qu’il nécessite sont accompagnées de services limités et de temps d’attente trop longs. Les débats pour trouver des sources de financement se multiplient, alors que beaucoup pensent qu’il serait insensé de majorer le fardeau fiscal des Québécois, déjà un des plus élevés en Amérique du Nord. Certaines solutions se dessinent, mais restent controversées : l’implantation de frais modérateurs et l’ouverture vers le privé. La question des temps d'attente, dans les services d'urgences notamment, semble exemplaire : ceux-ci ne font que croître régulièrement, alors même que les responsables politiques, lors de chaque élection, font la promesse de faire diminuer ces temps... Le temps d'attente médian, au Québec, entre la référence par un omnipraticien et le début du traitement est passé de 7,3 semaines en 1993 à 16,5 semaines en 2009, ce qui représente une augmentation d'un peu plus de 2 mois. Ce temps d'attente est plus élevé que la moyenne canadienne qui était de 9,3 semaines en 1993 et de 16,2 semaines en 2007. Les programmes électoraux des différents partis, lors de chaque élection pratiquement, mettent la question de la santé à l'ordre du jour. Ainsi, en 2003, la santé constituait une des priorités du programme du Parti libéral du Québec qui a remporté les élections. Aujourd'hui néanmoins la question reste entière...
Aux dires de nombreux québécois, leur système de santé fonctionnait assez bien jusqu'en janvier 1996, date de l'arrivée de Lucien Bouchard (Parti Québécois) au poste de Premier Ministre du Gouvernement du Québec. Le budget provincial voté en 1999 fait état d'un déficit budgétaire nul obtenu par des coupes importantes dans les services publics et dans la santé notamment. Le déficit du Québec, dans les années 1996 et 1997, avait été, en outre, aggravé par les coupures de 2,3 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans les soins de santé. Afin d'obtenir l'annulation du déficit budgétaire, les responsables politiques québécois ont forcé le départ de 33000 personnes travaillant dans le système de santé : 1500 médecins, 4000 infirmières, 1800 auxiliaires ont pris volontairement et prématurément leur retraite tous en même temps. Dès lors, après avoir terrassé le système de santé, les politiciens se sont attelés à la tâche de le remettre en état!
Pire encore, le Parti Québécois qui est resté au pouvoir pendant une longue période (entre 1976 et 1985, puis entre 1994 et 2003) a contribué, par ses arguments, à faire croire aux citoyens québécois que l'appel au privé en matière de santé était une quasi hérésie. Si bien, qu'aujourd'hui encore, nombre de québécois sont réticents à faire appel au privé dans ce domaine, alors que chacun pourrait facilement comprendre que , dans un contexte de pénurie, ce n'est pas tant le privé qui est condamnable mais plutôt la façon dont le Gouvernement l'insèrerait au sein du système de santé. Le système de santé en France est souvent cité comme une référence mondiale et pourtant il fait appel au privé...
Encore une fois, cet exemple montre à la fois l'incohérence et le peu de vision à long terme des responsables politiques qui semblent, en outre, ignorer le fait que construire est souvent plus long et plus difficile que détruire...
Le cas de l'Union européenne : on constate, au cours de la crise actuelle particulièrement, combien la gouvernance de l'Union européenne est difficile. A une période où il serait nécessaire de faire preuve d'unité et de cohésion, les chefs d'Etats européens ne cessent de se diviser, de s'opposer, rendant chaque jour la situation de l'Union plus délicate et la fragilisant toujours plus... Lorsque les pères fondateurs de l'Europe ont entamés la « grande marche » vers la création de l'unité européenne, ils devaient, sans aucun doute, avoir en tête la projection future vers une gouvernance supra nationale de cet ensemble de nations. Or, leurs successeurs, même s'ils ont acceptés, apparemment sans réticence, de chevaucher le cheval de l'union, n'ont cessés de faire ressurgir les vieux démons nationaux à la moindre difficulté. Ils n'acceptent qu'avec beaucoup de précautions de perdre un pouce de leur pouvoir national au profit de l'Union. Lors de chaque élection nationale au sein des pays de l'Union européenne, il est remarquable de constater que les programmes des candidats ou des partis politiques sont, avant tout, des programmes nationaux et, que pratiquement rien n'est dit sur l'avenir de l'Union elle même. Quand verra t-on une élection nationale en Europe mettre en avant les questions proprement européennes ? Les difficultés actuelles de l'Europe dans les domaines monétaire, social ou économique sont en grande partie le résultat de ces divisions ou de cette indifférence envers les problèmes supra nationaux... Peut-on vouloir créer une nouvelle entité rassemblant vingt sept pays tout en maintenant la gouvernance au niveau de chaque nation ? Est-il raisonnable de s'engager dans le processus de la construction européenne tout en oeuvrant, en chaque occasion, à la construction de sa seule et propre nation ? Pourtant, il faut savoir que l'échec de l'Union européenne serait, à coup sûr, l'échec de chacune des nations constitutives. Le coup à payer, dans une telle éventualité serait considérable et les responsables politiques d'un tel désastre ne s'en relèveraient pas. Les citoyens européens ne doivent perdre de vue ce point de façon à pouvoir constamment le rappeler à leurs dirigeants....
Il serait facile de multiplier les exemples allant dans le même sens. Après s'être enlevés les moyens d'agir, dans une situation difficile donnée, nos responsables sont souvent portés à croire qu'il suffit de faire des promesses inconsidérées ou de la surenchère gratuite pour pouvoir séduire leur électorat et ainsi faire taire ses réticences. C'est, par exemple le cas du président français, Nicolas Sarkozy, qui a basé sa première campagne présidentielle sur la notion de « rupture », une nouvelle façon sans doute de qualifier la « révolution tranquille » chère aux Québécois. Trois ans après son accession au pouvoir, les français sont encore à la recherche de cette fameuse rupture. En tous cas, s'il y en a une elle est loin d'avoir améliorée la situation des citoyens français qui, aujourd'hui sont placés dans une situation socio- économique plus détériorée qu'avant l'élection. Pire encore, en prévision de la prochaine élection présidentielle de 2012, la « seconde rupture » semble déjà se profiler dans le programme électoral du candidat Sarkozy... Y croire serait, cette fois, faire preuve de masochisme de la part des citoyens français... L'incohérence en politique est source d'inefficacité, d'indécision et ouvre la porte à la perte de confiance des citoyens, au développement de l'individualisme et même à la corruption.
En conclusion, il ne faut pas oublié que, dans les sociétés démocratiques, les responsables politiques sont, généralement, les représentants, souvent élus, des citoyens. En conséquence, il apparaît utile que les citoyens, eux aussi, s'interrogent sur la cohérence de leurs choix politiques...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
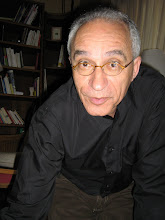
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire