Réunis en conférence de presse à Montréal, le 15 décembre 2011, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTPQ), ont rendu publics les résultats d'une enquête menée au cours des cinq derniers mois sur l'état des services préhospitaliers d'urgence au Québec. L'enquête révèle des statistiques très inquiétantes sur les temps d'intervention des ambulances dans plusieurs régions du Québec. L'enquête démontre également un manque d'ambulances sur plusieurs territoires, des délais non respectés sur des appels d'urgence, des temps d'attente qui peuvent être de 30, 40, 50 minutes et même plus pour des appels prioritaires, ainsi que plusieurs recommandations du coroner qui sont restées lettre morte.
A La Tuque au Québec, une femme de 75 ans de La Tuque a dû attendre l'ambulance durant près de 3 h 30 mercredi. Souffrant d'ostéoporose sévère, une vive douleur la clouait au lit de son appartement de la résidence pour personnes semi-autonomes, la Renaissance. La douleur rendait le voyage de deux kilomètres en voiture vers le Centre de santé et des services sociaux du Haut-St-Maurice (CSSSHSM) impossible.
Le 14 juin 2011, dans une Maison de naissance de Pointe-Claire, sur l'île de Montréal, un bébé est mort dans les bras d'une sage-femme suite au retard d'une ambulance de l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui prévoyait un délai d'attente de plus de 40 minutes.
Récemment, Radio-Canada relatait le cas d'une femme dont l'accouchement avait été difficile par suite de complications hémorragiques, qui a du attendre l'arrivée d'une ambulance plus de 4h...
Il est intéressant de mettre cette question des temps d'attente des ambulances des services de santé avec les délais et les moyens d'intervention des services de police et d'incendie au Québec.
L'école secondaire de Mortagne, à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, a été le théâtre, jeudi 1er mars, d'une vaste opération policière qui s'est soldée jeudi après-midi par l'arrestation de trois élèves, qui étaient en possession de deux fausses armes à feu. Deux mineurs, un garçon et une fille, qui auraient 16 ans, ont été arrêtés par les policiers de Longueuil. Ils se sont présentés à l'école avec un pistolet à plomb et un pistolet jouet, qui s'apparenterait à fusil de calibre 416.
Quatre-vingts policiers du service de police de Longueuil ont été dépêchés sur les lieux. Des maîtres-chiens et des enquêteurs se sont également présentés à l'école secondaire. Une procédure normale dans un cas comme celui-là, a expliqué Louise Gendron, commandante du district nord de la police de Longueuil. Un appel téléphonique a été adressé au 911 vers 11 h par un témoin qui a aperçu un jeune avec une arme longue dissimulée dans un sac à dos. L'autre arme avait été placée dans un casier. Les élèves ont été confinés dans les classes ou dans les gymnases. Vers 13h30, les policiers avaient presque terminé de faire le tour des classes et avaient fait évacuer graduellement les élèves.
Il est difficile de trouver des statistiques sur les délais et les moyens d'intervention des services de police du Québec, néanmoins chacun peut se rendre compte quotidiennement de l'importance des moyens mis en œuvre par la police ainsi que de la rapidité de ses interventions. Un observateur étranger peut d'ailleurs être surpris par l'importance des ressources mobilisées à l'occasion d'évènements anodins... Il n'est pas rare, par exemple, de voir deux grosses voitures de police et quatre policiers intervenir pour un banal incident de la circulation automobile. Autre exemple, de ce déploiement de moyens : très souvent les accès aux rues de la ville de Montréal sont fermés non pas par la pose de barrières mais par des véhicules de police avec chacun deux passagers à bord et le moteur en marche...
L'examen des interventions des pompiers de la ville de Montréal démontre que là aussi il n'y a pas de restriction sur les ressources, ce qui permet des délais d'intervention très courts. Le Service de sécurité incendie de Montréal affirme que la norme est de 5 minutes pour une intervention locale. Depuis environ quatre ans à la Ville de Montréal, le rôle des pompiers n'est plus seulement d'éteindre les feux. Environ les deux tiers de leurs interventions sont faites à titre de premiers répondants. Lorsqu'un citoyen appelle au 911 pour un problème médical, l'appel est acheminé en même temps au Service des incendies et à Urgences-santé. Les pompiers sont souvent les premiers arrivés sur place, en raison de la répartition des casernes dans toute la ville, ce qui leur permet d'être sur les lieux en quatre minutes et demie en moyenne. Leur rôle : donner les premiers soins, maintenir les fonctions vitales et stabiliser le patient en attendant l'arrivée des ambulanciers. Il n'est pas rare d'observer à Montréal la mobilisation de 5 ou 6 camions de pompiers pour ce qui ne se révèle qu'un simple incident sans conséquence...
Le rapprochement des faits concernant la santé d'une part, et la police et les pompiers d'autre part, me semble significatif du choix de priorités faites par les responsables politiques. Il y a une certaine démesure de ressources du côté de la police et des pompiers alors que pour les services de santé et pour les ambulances, notamment on observe des ressources restreintes. Il me semble pourtant que la sécurité des citoyens ne peut être garantie si on n'assure pas le bon fonctionnement du système de santé. Le maintient de l'ordre et la lutte contre les incendies ne peuvent suffire à assurer la protection des citoyens...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
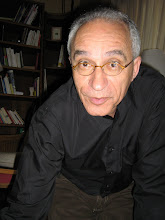
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire