Il est communément reconnu de nos jours que les gens se sentent souvent impuissants face aux évènements qui les affectent. Plus grave encore, les individus semblent penser que les responsables politiques et les autres, sont incapables de régler les problèmes de nos sociétés. En fait, il n'est pas difficile de constater combien les Etats et Gouvernements, eux aussi, sont impuissants ou inefficaces face aux principaux problèmes qui se posent dans nos sociétés. Un exemple : la réalisation de l'Etat de droit dans les sociétés dites démocratiques. Ces dernières devraient aujourd'hui être capables d'assurer à leurs citoyens les droits fondamentaux tels, par exemple, le droit au logement, ou le droit à la nourriture ou encore le droit au travail... Il est pourtant notoire que ces droits sont de moins en moins garantis dans ces sociétés pourtant dites de droit. C'est là une faillite considérable. Pire que tout, certains de ces droits semblent, aujourd'hui, dans un état de régression avancé. Comment expliquer, par exemple, que le nombre de pauvres dans ces sociétés va en augmentant au lieu de diminuer ? Comment justifier que l'écart entre riches et pauvres soit, lui aussi, croissant ? Comment des Gouvernements dits démocratiques peuvent-ils se satisfaire de l'enrichissement toujours plus grand d'une partie de la société, tandis que la frange la moins favorisée s'appauvrit toujours plus ?...
Il semble intéressant de mettre en relation ce sentiment d'impuissance avec la multiplication des réunions, colloques, rassemblements de toute nature consacrés à des sujets de société. Les experts sont systématiquement appelés à se prononcer sur tous les problèmes et ils ne s'en privent pas... Si l'on se donne la peine de dénombrer les réunions, les écrits, les articles, les colloques consacrés à un sujet particulier, il serait facile de démontrer que ce nombre est quasiment inversement proportionnel à l'efficacité à régler le problème en question... Tout semble se passer comme si la multiplication des occasions de réflexion sur un thème s'accompagnait presque toujours d'une diminution de l'action exercée en vue de résoudre les questions concernées... Faut-il en déduire que tous ces Sommets, colloques, rassemblements, ... sont inutiles ? Les réunions sur le réchauffement climatique sont certainement exemplaires à cet égard...
On pourrait s'interroger sur le lien qui existe entre la multiplication des occasions de réflexion et la réalité de l'action exercée ? L'individu en passant trop de temps à débattre, à discuter ou à réfléchir, obère t-il sa capacité à agir ? Il s'agit là d'une question déjà bien étudiée qui pourrait se résumer par : la réflexion est-elle un frein à l'action ? Les individus, inconsciemment, pensent-ils, qu'une fois débattu un problème, il serait déjà en voie de solution ? Ou alors pensent-ils, qu'une fois discutée une question, son règlement concret en revient à d'autres personnes ?
En outre, si l'on y regarde de près, les conclusions des rapports d'experts sont souvent peu clairs, voire même contradictoires. Il n'est pas rare de trouver dans ces rapports des recommandations qui sont opposées. Dès lors, il est normal de ne pas pouvoir les mettre en pratique. La question des 35 heures de travail, en France, en est une illustration : les socialistes, alors qu'ils étaient au pouvoir, ont instaurés cette mesure en la justifiant par un argument qui paraissait imparable lorsque le travail manque, il faut le partager pour que le plus grand nombre puisse en avoir. Le patronat et la droite française, une fois au pouvoir, ont ensuite tout fait pour détruire cette mesure avec une argumentation qui semblait tout autant valable on ne peut pas travailler moins en France alors que partout dans les autres pays concurrents le temps de travail est supérieur. Récemment, (voir le Journal Le Monde du 4 janvier 2010) l'économiste britannique Tim Jackson, professeur et chercheur à l'université de Surrey (Grande-Bretagne) indiquait, dans un entretien avec un journaliste que Le choix (pour combattre le chômage notamment) est donc soit de conserver la croissance de la productivité et d'admettre par conséquent qu'il y aura moins de travail dans l'économie, ce qui signifie la mise en place de politiques de réduction du temps de travail; soit opter pour la fin de la hausse de la productivité, et développer les services sociaux – éducation, aide sociale, maintien des espaces publics, rénovation des bâtiments, etc. Récemment, la polémique a rebondit après la charge du socialiste Français Manuel Valls contre les 35 heures et la réponse faite par Pierre Larrouturou, économiste et pilote des Etats généraux de l'emploi organisés par Europe Ecologie – Les Verts. Pour ce dernier (voir le journal Le Monde du 7 janvier 2010) il n'est pas vrai que l'on travaille moins en France qu'ailleurs : La durée hebdomadaire moyenne du travail pour les personnes ayant un emploi à temps complet est de 41 heures en France.
Alors, qui faut-il croire ?
Un autre aspect de ce problème concerne la transmission des rapports d'experts. Lorsque ceux-ci sont demandés par des autorités identifiées, il est naturel de les transmettre à celles-ci. Cependant, souvent, les initiatives de ces rapports reviennent à des membres de la société civile ou à des experts indépendants et, dans ce cas, il n'est pas facile de repérer les personnes à qui transmettre les conclusions...
Par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion dans des chroniques précédentes (voir notamment celle du 21 août 2010), de me pencher sur la grande dispersion qui règne au sein des circuits de décision. Cette situation ne facilite pas la prise de décision. Il n'est pour s'en convaincre que d'observer le cas de l'Union européenne, empêtrée dans un processus de décision tellement complexe que l'on peut être surpris que, de temps en temps, il puisse en sortir quelque chose de concret....
Comment faire pour corriger la situation ? Il est clair que cette réalité doit être modifiée assez rapidement, faute de quoi, on pourrait se retrouver dans une configuration où le plus fort sera celui qui décide. La loi du plus fort a eu son heure de gloire mais elle ne peut, aujourd'hui, être évoquée comme solution à nos maux...
De nombreux phénomènes viennent de nos jours, contribuer à rendre le citoyen passif : la télévision, notamment, en nous figeant devant un écran, peut atténuer notre capacité à agir. Le marketing exerce une emprise extravagante sur les personnes. Le stress au travail vient épuiser les énergies des personnes...
Face à cette tendance forte, il convient de re apprendre à réfléchir par soi-même, à analyser les évènements à la lumière de son bon sens, de sa propre expérience, de sa vision personnelle des choses... Il faut cultiver l'esprit critique et retrouver ses capacités d'action individuelle. Sans rejeter l'intérêt de la réflexion collective, il convient d'asseoir celle-ci sur un jugement individuel aussi approfondi et assuré que possible...
L'éducation et la formation sont, sans doute, des leviers déterminants pour parvenir à atteindre ces objectifs mais il ne faut sous estimer ni la lecture, ni le temps accordé à la réflexion personnelle...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
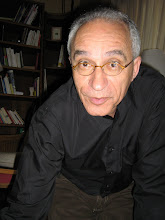
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire